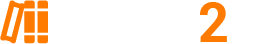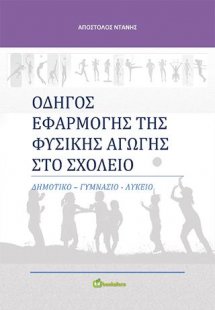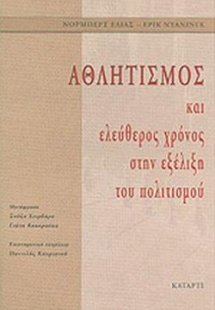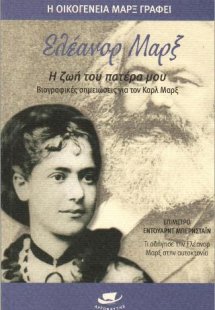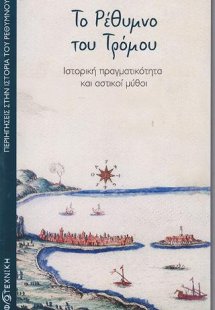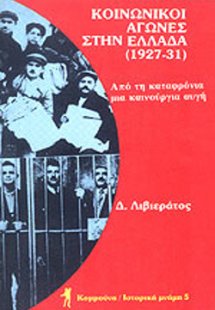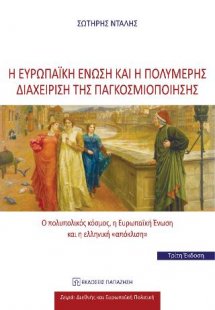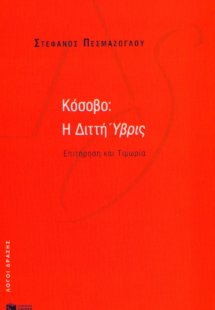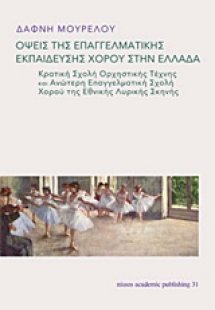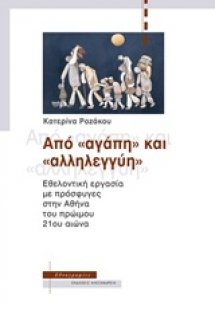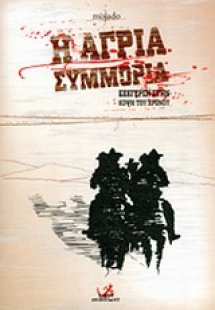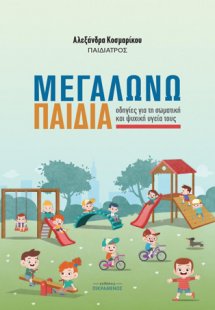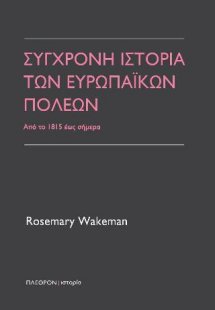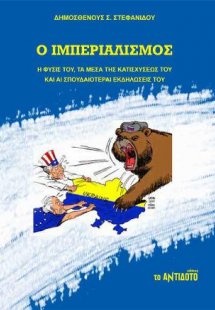Étude historique sur la censure des films en France
Περιγραφή:
L’évolution des régimes de l’expression cinématographique en France entraînerait deux transitions consécutives ainsi résumées: de la censure au contrôle et du contrôle à la classification. On a depuis longtemps dépassé le stade de la censure sans pour autant que la transition du contrôle à la classification des œuvres cinématographiques soit juridiquement accomplie. Voilà l’idée maîtresse qui servit de fil d’Ariane à l’auteur, dans le dédale de normes juridiques du 20e siècle.
En janvier 1909, à Béthune, une exécution capitale de quatre bandits fut enregistrée subrepticement par les opérateurs Pathé, malgré l’interdiction du ministre de la justice. Le ministre de l’intérieur adressa à tous les préfets, le 11 janvier 1909, une circulaire télégraphique, où il estimait qu’«il est indispensable d’interdire radicalement tous les spectacles cinématographiques publics de ce genre». La fascination qu’exerce le spectacle de la mort sur le public est donc à l’origine du premier texte officiel de la censure cinématographique, autrement dit, l’«acte de naissance» de celle-ci. Or, l’évolution historique de la réglementation en France, jusqu’aux années ’70, montre clairement la volonté tenace des pouvoirs publics de soumettre l’expression cinématographique à une police administrative vigilante. Une telle volonté poursuivait avant tout un but de «prophylaxie sociale» teinté de desseins protectionnistes ou propagandistes en périodes de crise ou de guerre. En réalité, la censure et la propagande par occultation s’interpénétraient, sans pouvoir démêler l’une de l’autre. La censure se voulait, alors, un instrument fiable de la propagande, même au sein des régimes démocratiques. Comme disait d’ailleurs Pierre Legendre, «l’accès au cœur de la censure est… le décryptage d’un discours». Ceci fait que pour restituer le «sens» d’une disposition juridique, que celle-ci soit impersonnelle ou individuelle, c’est-à-dire isoler ce qui sert à justifier son existence, il fallait la placer au sein du contexte social, politique, économique et technologique qui lui était propre. D’où la construction des cadres temporels suivants: 1909-1915, 1916-1918, 1919-1927, 1928-1935, 1936-1938, 1939-1944, 1945-1960, 1961-1973, et 1974-1975.
En bref, une étude sur la censure des films en France ne pouvait aller au-delà des débuts du septennat giscardien. Tant la reconnaissance d’une liberté d’expression cinématographique par le Conseil d’État, dans l’affaire du film Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot (24 janvier 1975), que la mise en place d’un régime de pénalisation fiscale et financière pour les films et les salles classés ‘X’ indiquent qu’un «régime de contrôle» succéda effectivement à la censure d’antan.
Étude suivie de La politique symbolique et les films “X”. Un souvenir de l’époque giscardienne, dans une nouvelle version entièrement revue et augmentée par l’auteur, et de 54 documents, datés de 1909 à 1976, concernant la censure et le contrôle cinématographiques, en France.